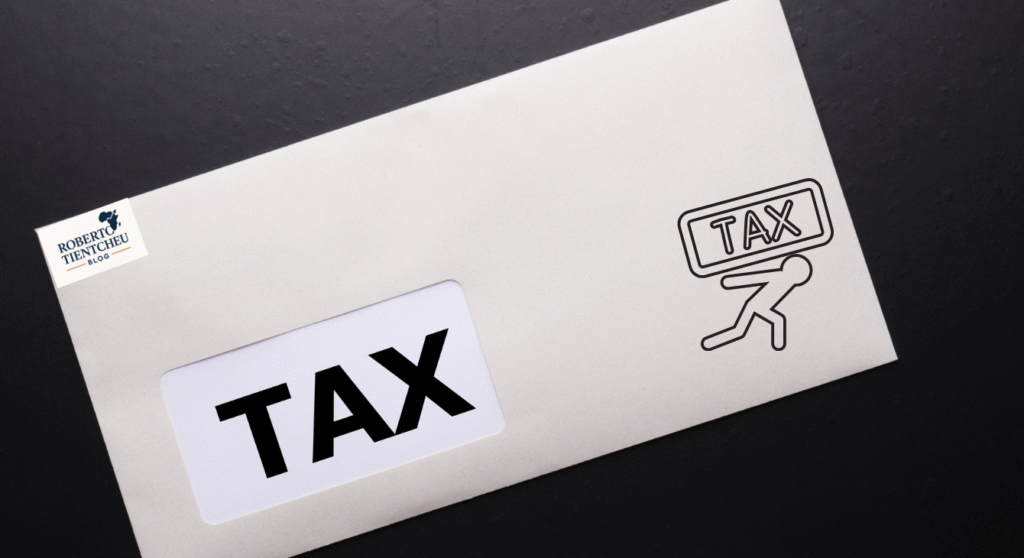L’impôt est l’une des plus anciennes institutions de l’économie politique. Depuis l’Antiquité, il incarne à la fois un outil de financement collectif et un rapport de force entre gouvernants et gouvernés. Pourtant, après des siècles de perfectionnement, il demeure paradoxalement fragile. Selon le FMI (2022), l’évasion fiscale mondiale représente près de 600 milliards de dollars par an. Dans l’Union européenne, la fraude prive les États de 1 000 milliards d’euros, soit environ 5 % du PIB. En Afrique, les recettes plafonnent à 13–15 % du PIB, bien en deçà du seuil de 20 % nécessaire pour financer un État moderne. Ces chiffres traduisent une réalité simple : l’impôt est de plus en plus contesté. Les classes moyennes dénoncent un système qui les écrase, tandis que les élites fortunées disposent des moyens de contourner ou de déplacer leur base imposable. Résultat : une « fiscalité à deux vitesses », où l’égalité devant la loi s’effrite et nourrit la colère, des Tea Party américains aux « gilets jaunes » français.
Cette défiance se traduit par deux attitudes : la contestation ou la fuite. Une partie des citoyens proteste contre ce qu’ils perçoivent comme un prélèvement sans retour équitable ; d’autres, lorsqu’ils en ont les moyens, choisissent l’exil fiscal. Les entrepreneurs français partis en Belgique ou en Suisse après l’instauration de l’ISF en sont l’illustration. Les multinationales, elles, déplacent artificiellement leurs bénéfices vers l’Irlande ou le Luxembourg. Dans le Sud global, la migration prend une autre forme : des classes moyennes quittent leur pays pour chercher ailleurs des États où les impôts, même élevés, garantissent éducation, santé et infrastructures. L’impôt devient ainsi un facteur de mobilité, voire une rupture silencieuse du lien civique. Pourtant, les données révèlent un paradoxe : malgré des taux de contrôle très faibles (environ 1 % dans l’OCDE), plus de 80 % des citoyens paient leurs impôts, et la conformité dépasse 95 % dans les pays nordiques. Si la peur du contrôle était l’unique ressort, l’impôt aurait disparu depuis longtemps. La vérité est plus brutale : les gens paient tant qu’ils croient que les autres paient aussi, que l’État redistribue avec équité et que leur contribution sert un bien commun. Là où cette conviction s’effondre, comme en Grèce lors de la crise, le consentement fiscal s’évapore et la faillite budgétaire s’accélère. À l’inverse, en Suède ou en Finlande, la transparence radicale chacun pouvant consulter les déclarations de ses voisins entretient une discipline collective que nulle sanction ne saurait imposer.
Les « nouvelles taxes » ont échoué à enrayer cette défiance. La taxe carbone française, présentée comme un outil de transition, s’est transformée en symbole d’injustice sociale et a déclenché la colère des « gilets jaunes ». En Suède, la même taxe a contribué à réduire les émissions de 27 % en trente ans, mais grâce à une confiance institutionnelle largement supérieure. Les taxes sur les billets d’avion frappent surtout les classes moyennes, laissant intacts les jets privés. Quant à la taxe GAFA, elle n’a rapporté en France que 400 millions d’euros en 2021, une somme dérisoire face aux dizaines de milliards transférés hors du pays par les géants du numérique. Ces mesures illustrent un même constat : une taxe n’est pas jugée à son rendement, mais à sa légitimité. Lorsqu’elle frappe injustement ou finance autre chose que son objectif affiché, elle se transforme en caricature et alimente la défiance.
Dès lors, il faut reconnaître que la crise est moins une crise de légitimité qu’une crise de conception. L’impôt d’aujourd’hui repose sur les « immobiles » classes moyennes, salariés, PME pendant que les « mobiles » fortunes mondialisées et multinationales échappent largement à l’effort collectif. Les pays en développement perdent chaque année plus de 200 milliards de dollars dans les transferts artificiels de bénéfices, une somme supérieure à toute l’aide internationale qu’ils reçoivent. Aux États-Unis, les 400 familles les plus riches paient proportionnellement moins que des enseignants ou des soignants. En France, la suppression de l’ISF a nourri l’idée que les plus riches pouvaient se soustraire à leur part sans relancer pour autant l’investissement productif. Ce n’est donc pas l’impôt comme institution qui est rejeté, mais la manière dont il est conçu : inégalitaire, opaque et inefficace.
La sortie de cette impasse suppose des ruptures, pas des retouches. Première rupture : imposer une transparence totale. Les budgets doivent être publics, les affectations traçables en temps réel, et chaque contribuable doit pouvoir suivre l’usage de son argent. Sans cette révolution, le soupçon d’opacité continuera de miner la confiance. Deuxième rupture : briser l’impunité fiscale des élites mondialisées. Cela implique des mesures sans négociations : confiscation des avoirs non déclarés, sanctions extraterritoriales contre les multinationales pratiquant l’évasion, exclusion des marchés publics pour les entreprises qui refusent la transparence pays par pays. Troisième rupture : rendre une part de l’impôt orientable par les citoyens. Donner la possibilité d’affecter une fraction de sa contribution à la santé, à l’éducation ou aux infrastructures transformerait l’acte de payer en un choix politique, et non en une contrainte aveugle. Ces propositions dérangent parce qu’elles attaquent les tabous : elles arrachent aux États leur opacité budgétaire, elles obligent les élites économiques à contribuer réellement, elles donnent aux citoyens un pouvoir direct. Mais c’est précisément ce qui manque. Tant que l’impôt sera un système à deux vitesses, tant que les classes moyennes porteront seules la charge pendant que les riches négocient et que les multinationales fuient, la défiance s’amplifiera. Et avec elle, la spirale de la fuite : fuite des capitaux, fuite des talents, fuite de la confiance. L’impôt n’est pas un simple mécanisme technique : il est le dernier lien entre démocratie et légitimité. Si ce lien se rompt, les États ne survivront que par la rente, la dette ou la surveillance.