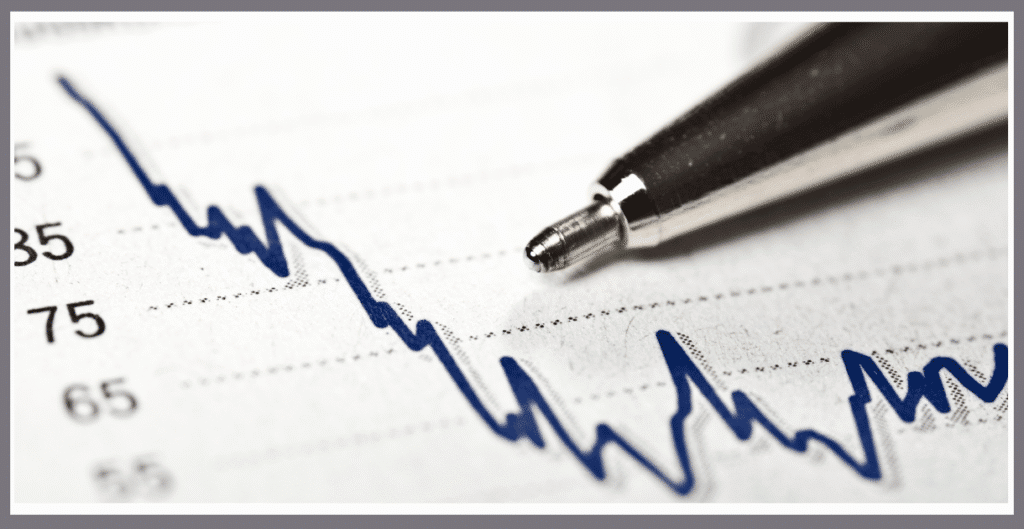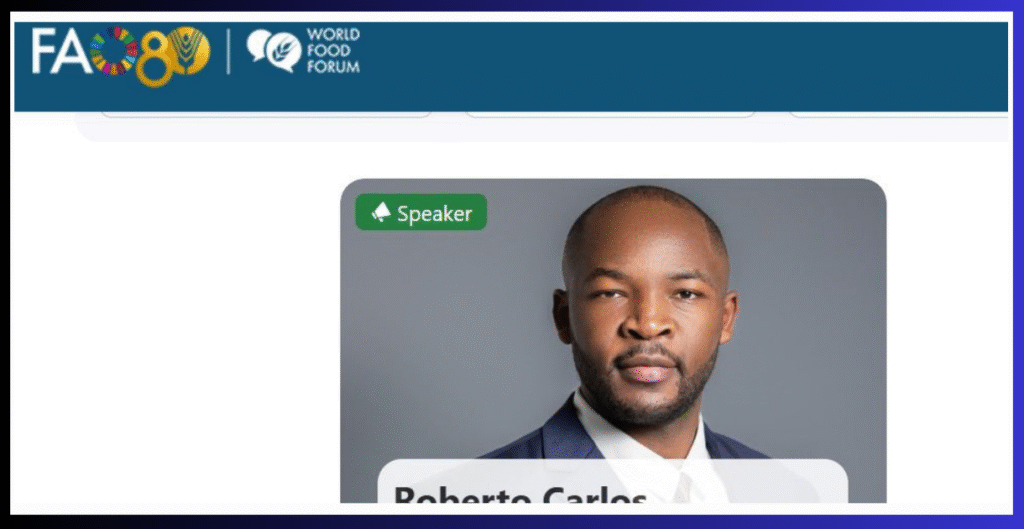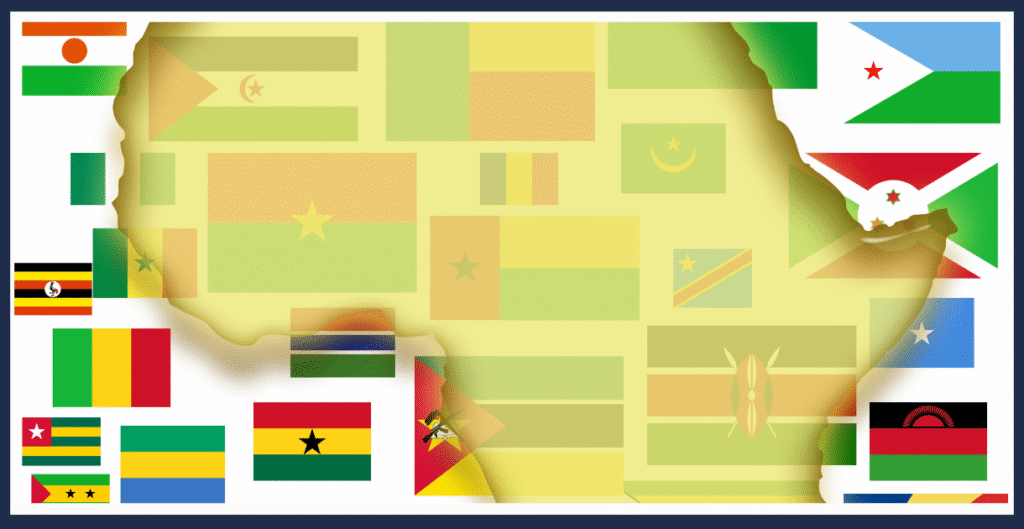Le Soudan est aujourd’hui le théâtre de la plus vaste crise de déplacement au monde. Selon l’OCHA, 14,5 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en avril 2025, dont 10,5 millions de déplacés internes et près de 4 millions ayant traversé les frontières vers des pays voisins tels que l’Égypte, le Tchad ou le Soudan du Sud (OCHA, 2025). Cette catastrophe humanitaire n’est pas le fruit d’un seul facteur, mais bien d’une double contrainte dévastatrice : un conflit armé prolongé qui détruit l’économie et paralyse les institutions, et une vulnérabilité climatique aggravée par des pluies diluviennes qui provoquent inondations et destructions agricoles. Le système de santé est au bord de l’effondrement, tandis que la faim atteint des niveaux critiques. La situation n’est pas inédite pour le pays ou la région. Les famines soudanaises des années 1980, la crise du Darfour en 2003-2005 et la famine en Somalie en 2011 rappellent que dans cette partie du continent, conflits et climat interagissent de façon récurrente pour transformer des chocs ponctuels en crises structurelles (De Waal, 2015). C’est cette logique, à la fois historique et contemporaine, que cet article analyse, en cherchant à mettre en lumière les causes profondes, les dynamiques actuelles et les perspectives de sortie possibles.
Le conflit armé et l’effondrement économique
Depuis avril 2023, les Forces armées soudanaises (SAF) dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (RSF) de Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti, s’affrontent dans une guerre qui a plongé le pays dans le chaos. Khartoum et d’autres villes stratégiques sont devenues des zones de combat, les routes commerciales sont bloquées, les dépôts alimentaires détruits et l’industrie paralysée. Selon l’IFPRI, les pertes économiques atteignent environ 15 milliards de dollars fin 2023, soit près de la moitié du PIB du pays (IFPRI, 2024). Ce choc d’offre massif s’est immédiatement traduit par une flambée des prix alimentaires, rendant les produits de base inaccessibles pour une grande partie de la population. L’utilisation de la faim comme arme politique, déjà observée pendant la guerre civile de 1983-2005, ressurgit aujourd’hui, avec des groupes armés contrôlant les routes d’approvisionnement et bloquant l’aide humanitaire (Maxwell, 2014).
La guerre a aussi provoqué la plus grande crise de déplacement au monde. Plus de 14 millions de personnes ont fui leur foyer, dont près de 4 millions se sont réfugiées dans les pays voisins. Le Tchad accueille près d’un million de réfugiés, l’Égypte plus d’un million et demi, et le Soudan du Sud est saturé par un flux qui dépasse de loin ses capacités d’accueil (UNHCR, 2025).
Ces migrations massives créent une pression considérable sur les infrastructures locales et les ressources naturelles, tout en alimentant de nouvelles tensions sociales. Comme au Darfour dans les années 2000, les camps de réfugiés deviennent des micro-économies précaires, dépendantes de l’aide internationale.
Enfin, le conflit met en lumière la faiblesse des institutions soudanaises. Le système de santé illustre cette faillite : selon HeRAMS, près de 70 % des hôpitaux de Khartoum ne sont plus fonctionnels (HeRAMS, 2024). Les établissements fermés, le manque de personnel qualifié et l’insécurité généralisée privent des millions de personnes d’accès aux soins. Cette faiblesse institutionnelle n’est pas nouvelle. Elle est enracinée dans un héritage colonial, des décennies d’instabilité politique et des politiques économiques incohérentes. Le résultat est un État incapable de répondre aux besoins de base, ce qui favorise la criminalité transfrontalière, le trafic d’armes et la traite d’êtres humains.
Les pluies diluviennes et la vulnérabilité climatique
À la violence armée s’ajoute la vulnérabilité climatique. Le Soudan dépend largement de l’agriculture pluviale, ce qui le rend particulièrement exposé aux aléas météorologiques. Depuis trois ans, la saison des pluies est marquée par des précipitations d’une intensité exceptionnelle, qui provoquent des inondations et des destructions massives. En 2024, la rupture du barrage d’Arba’at a inondé des villages entiers et provoqué des déplacements supplémentaires. Les routes deviennent impraticables, entravant l’accès humanitaire, tandis que les cultures de sorgho et de mil sont détruites, accentuant la pénurie (FAO, 2024).
Les conséquences sanitaires sont alarmantes. En 2025, près de 60 000 cas de choléra et plus de 1 600 décès ont été enregistrés, auxquels s’ajoutent des flambées de paludisme et de dengue (WHO, 2025). Ces maladies réduisent encore la capacité des ménages à produire et à subvenir à leurs besoins. L’histoire montre que le climat a déjà joué ce rôle de catalyseur. Dans les années 1970 et 1980, les sécheresses avaient déclenché des famines. Aujourd’hui, ce sont les inondations qui remplissent cette fonction destructrice. Le facteur commun reste la vulnérabilité structurelle, fruit de décennies de désinvestissement.
Cette vulnérabilité s’explique aussi par les choix économiques passés. Les programmes d’ajustement structurel des années 1990 ont réduit les investissements publics dans l’agriculture et affaibli les filets de sécurité. L’absence de modernisation des systèmes d’irrigation et de stockage a laissé les paysans dépendants des aléas climatiques (World Bank, 2023). Les inondations exacerbent aussi les tensions sociales. Les populations déplacées se retrouvent en compétition avec les communautés d’accueil pour la terre et l’eau, aggravant les rivalités entre agriculteurs et éleveurs. Comme au Darfour, climat et guerre s’entrelacent, renforçant mutuellement leurs effets dévastateurs.
Une famine aux multiples dimensions
Le résultat est une crise alimentaire généralisée. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 25 millions de Soudanais souffrent d’insécurité alimentaire aiguë en 2025. Trois millions d’enfants de moins de cinq ans pourraient être touchés par la malnutrition, dont 770 000 en danger de mort (WFP, 2025). Dans certaines régions du Darfour et des Monts Nouba, l’IPC classe déjà la situation en Phase 5, celle de la famine. Les impacts dépassent la survie immédiate. La malnutrition chronique entraîne une perte de capital humain, avec des retards cognitifs et une productivité future amoindrie. C’est une véritable trappe à pauvreté intergénérationnelle qui se met en place (FAO & IFPRI, 2024).
Les disparités régionales et sociales sont frappantes. Les zones rurales sont plus vulnérables que les villes, mais Khartoum elle-même est touchée par l’effondrement des marchés. Les femmes, qui représentent environ 70 % des déplacés internes, paient le prix le plus élevé. Elles sont souvent responsables de la survie domestique, tout en étant exposées à des violences et à l’exploitation sexuelle lorsqu’elles tentent d’obtenir de la nourriture. Dans certaines communautés, les normes sociales les obligent à servir les hommes en premier, aggravant leur risque de malnutrition. Comme au Sud-Soudan durant la guerre civile, elles deviennent les gestionnaires de la survie, mais au prix d’un appauvrissement nutritionnel et social profond.
La crise entraîne aussi des conséquences socio-économiques majeures. Les ménages adoptent des stratégies extrêmes comme la consommation de racines ou le mariage précoce des filles. Le travail des enfants devient une stratégie de survie, mais enferme les familles dans un piège de pauvreté durable, comme observé en Somalie en 2011 ou au Niger en 2005 (Maxwell & Fitzpatrick, 2012). L’inflation alimentaire dépasse 200 % pour certains produits, rendant la nourriture inaccessible même lorsqu’elle existe sur les marchés. Le taux de pauvreté atteint 65 % de la population fin 2023, accentuant le déclin socio-économique.
Réponse humanitaire et ses limites
La communauté internationale s’est mobilisée. Le PAM distribue des rations alimentaires, l’OMS envoie des kits médicaux, l’OIM soutient des millions de déplacés et de nombreuses ONG agissent sur le terrain. Cependant, l’efficacité de cette réponse reste limitée. Comme en Éthiopie en 1984 ou au Darfour en 2003, l’aide est entravée par l’insécurité, la manipulation politique et les obstacles logistiques.
Le financement reste insuffisant : en 2024, l’OIM n’avait reçu que 39 % des fonds requis (OIM, 2024). La fatigue humanitaire est palpable, comme en Somalie en 2011, où les fonds sont arrivés trop tard malgré les alertes précoces (UNOCHA, 2012). Les convois humanitaires sont attaqués, les routes inondées, et des cas d’abus, y compris sexuels, en échange d’aide, minent la confiance des populations.
Surtout, l’urgence ne suffit pas. L’aide alimentaire soulage temporairement, mais ne rétablit ni la production agricole ni les marchés. Comme l’ont montré les programmes du Niger ou l’expérience du Productive Safety Net Programme en Éthiopie, seule une combinaison de transferts sociaux, d’investissements agricoles et de réformes structurelles peut briser le cycle (World Bank, 2022).
Quelles perspectives pour briser le cycle ?
Sortir de ce cercle vicieux suppose d’agir à trois niveaux. Le premier est l’urgence humanitaire. Chaque jour de retard coûte des vies. Financer immédiatement les opérations, sécuriser les couloirs humanitaires et garantir le respect du droit international sont des conditions minimales. La Somalie en 2011 a montré combien un retard de réponse pouvait coûter des centaines de milliers de vies.
Le deuxième niveau concerne les réformes structurelles. Le Soudan doit investir dans l’irrigation, le stockage, les routes rurales et la santé publique. L’exemple du PSNP éthiopien démontre qu’il est possible de transformer une aide d’urgence en filet de sécurité durable (Berhane et al., 2014). Le renforcement du système de santé et la mise en place de politiques agricoles résilientes au climat sont indispensables.
Enfin, sans paix, aucune stratégie ne pourra tenir. Le processus politique doit être inclusif et porté par les Soudanais eux-mêmes, sous l’égide de l’Union africaine. Chaque crise passée, des années 1980 au Darfour, montre que sans institutions légitimes et un État fonctionnel, aucune aide ne produit d’effets durables.
La famine au Soudan illustre le nœud conflictuel entre guerre et climat. Plus de 30 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire en 2025, soit une augmentation de 23 % en un an. Le coût humain est immense, mais le coût économique l’est tout autant, car c’est tout le capital humain d’une génération qui est en danger. La réponse doit combiner urgence, réformes structurelles et gouvernance inclusive. Le Soudan n’est pas un cas isolé. Il est le miroir des crises “conflit-climat” qui menacent le Sahel et la Corne de l’Afrique. Agir aujourd’hui, c’est non seulement sauver un peuple, mais aussi tirer des leçons essentielles pour l’avenir de la région et pour l’humanité entière.