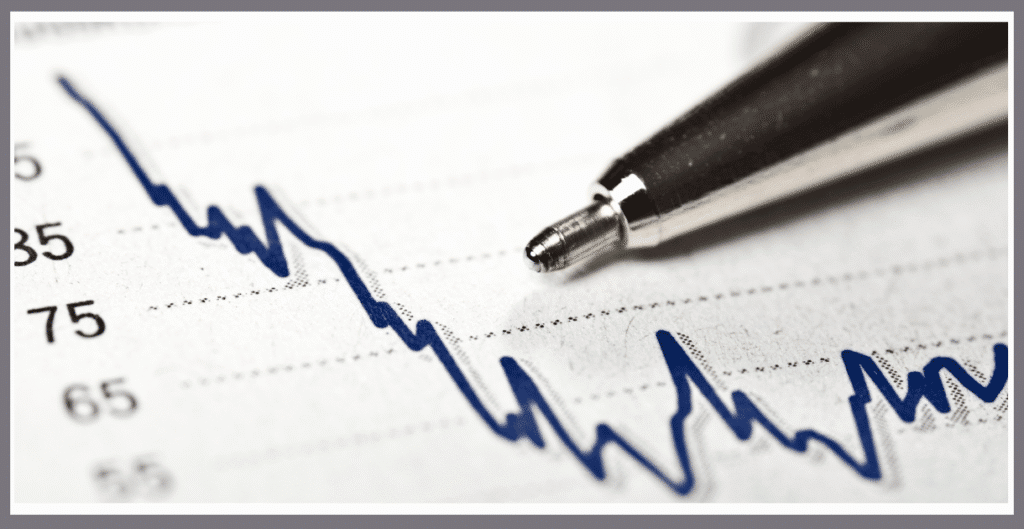Le chômage en Afrique est un paradoxe statistique et une énigme économique. Depuis trente ans, les chiffres officiels oscillent entre 6 et 12 % de chômage ouvert, des taux comparables à ceux de l’Europe. Pourtant, la réalité quotidienne contredit ce tableau rassurant. Derrière ces chiffres, on trouve une jeunesse massivement sous-employée, des millions de diplômés contraints d’occuper des petits boulots informels, et une main-d’œuvre agricole prisonnière de la subsistance. Le véritable visage du chômage africain n’est pas l’oisiveté complète, mais l’informalité et la précarité : aujourd’hui, plus de 80 % des emplois sont informels, et plus de 60 % des jeunes actifs sont sous-employés.
La difficulté tient à la définition même du chômage. Dans de nombreux pays, vendre quelques fruits sur un marché ou tenir un téléphone pour des micro-transactions suffit à être classé comme « occupé ». En Afrique, « ne pas être au chômage » n’implique ni stabilité, ni productivité. Cette faille statistique masque l’ampleur du problème : chaque année, près de 20 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail, mais seuls 3 millions d’emplois formels sont créés. Autrement dit, 17 millions de jeunes restent sans emploi stable année après année. À l’horizon 2050, le continent devra absorber 450 millions de jeunes supplémentaires. Ce décalage vertigineux est le défi économique central du XXIᵉ siècle.
Au début des années 1990, l’Afrique sortait des ajustements structurels imposés par le FMI et la Banque mondiale. Ces réformes ont réduit les déficits publics mais comprimé brutalement la fonction publique et les subventions agricoles. Les privatisations ont ouvert de nouveaux marchés, mais ont aussi supprimé des centaines de milliers d’emplois stables. C’est dans cette période qu’a commencé à s’ancrer une dynamique : un marché du travail où les jeunes ne trouvent pas de place dans le secteur formel, mais s’entassent dans des activités de survie.
Les années 2000 ont marqué un rebond spectaculaire. Portées par le boom des matières premières et la stabilisation politique, de nombreuses économies ont affiché 5 à 6 % de croissance annuelle. C’était l’ère du NEPAD, des Objectifs du Millénaire pour le Développement et d’une Afrique enfin décrite comme « en marche ». Mais la croissance fut extensive plutôt qu’inclusive. Le secteur extractif, les BTP financés par la rente pétrolière, et les services peu qualifiés ont gonflé le PIB sans créer de véritables emplois productifs. Au milieu des années 2000, l’informel représentait toujours près de 90 % de l’emploi total.
La crise financière de 2008 a brutalement révélé la fragilité de ce modèle. La chute des cours du pétrole, du cuivre ou du cacao a provoqué des récessions, montrant que l’Afrique dépend trop des cycles mondiaux. Des millions de jeunes urbains qui avaient placé leurs espoirs dans la croissance se sont retrouvés face à une économie incapable de les absorber.
La décennie 2010 a apporté deux grandes dynamiques : l’explosion démographique et la transition numérique. Les téléphones portables ont transformé la vie quotidienne, créant des niches dans le mobile money, l’e-commerce ou la logistique. Mais ces emplois, aussi innovants soient-ils, restent une goutte d’eau dans l’océan. Face aux 20 millions de nouveaux entrants annuels, le numérique ne peut compenser l’absence d’industrialisation. Même avec une croissance de 6 %, l’Afrique ne crée pas assez d’emplois pour suivre sa démographie. Puis vint la pandémie de Covid-19. Le confinement a paralysé les économies urbaines informelles, révélant à quel point la survie de millions de familles dépend de revenus quotidiens instables. Le chômage des jeunes a explosé, les écoles ont fermé, les migrations internes ont gonflé les bidonvilles. Les aides sociales d’urgence ont été vitales, mais elles ont souligné une vérité : les transferts atténuent la douleur, mais ils ne construisent pas l’avenir.
L’Afrique n’est pas homogène. Le Maghreb affiche des taux de chômage des jeunes supérieurs à 25 %, proches du modèle méditerranéen. En Afrique de l’Ouest côtière, comme au Ghana ou en Côte d’Ivoire, la croissance a créé des emplois mais souvent précaires. Le Sahel reste dominé par l’agriculture de subsistance, où la sous-utilisation de la main-d’œuvre est massive. L’Afrique de l’Est, avec l’Éthiopie comme exemple phare, a expérimenté des zones industrielles et des politiques manufacturières, réussissant partiellement à absorber des travailleurs dans le textile avant la pandémie. Ces nuances montrent qu’il n’y a pas un chômage africain, mais plusieurs réalités imbriquées.
Le cœur du problème est productif. Former davantage de jeunes ne sert à rien si les emplois n’existent pas. Encourager l’entrepreneuriat ne suffit pas si l’environnement économique reste hostile aux PME. Les aides sociales sont vitales mais ne changent pas la donne. La clé est ailleurs : transformer la structure économique. Les comparaisons sont éclairantes. La Corée du Sud et le Vietnam ont absorbé leur jeunesse grâce à une industrialisation rapide, une montée en gamme des services et une intégration aux chaînes de valeur mondiales. L’Afrique, en revanche, reste prisonnière d’un modèle extractif et de services peu qualifiés. Tant que l’investissement privé productif reste inférieur à 20 % du PIB et que la productivité manufacturière ne croît pas de plus de 3 % par an, le chômage des jeunes restera insoluble.
Trois dimensions aggravent la crise de l’emploi en Afrique mais demeurent trop souvent reléguées au second plan. La première est le genre : les femmes constituent la majorité de la main-d’œuvre informelle, cantonnées à des activités faiblement rémunératrices et rarement protégées. Privées d’accès sécurisé au foncier, au crédit ou aux services de garde, elles voient leur potentiel économique étouffé et la productivité globale du travail freinée. La seconde est le climat, qui fragilise les bases mêmes de l’emploi rural. La baisse de la productivité agricole, amplifiée par les sécheresses et les inondations, pousse chaque année des millions de ruraux vers les villes, où ils s’ajoutent aux armées de travailleurs informels. Enfin, la dimension de la gouvernance est centrale : la captation des rentes minières et la corruption siphonnent des ressources publiques qui pourraient financer des infrastructures, soutenir l’agro-industrie et stimuler la création d’emplois productifs. Autrement dit, le chômage africain n’est pas seulement un problème technique d’offre et de demande de travail : il est aussi enraciné dans des structures sociales, environnementales et politiques qui amplifient sa persistance.
Cinq leviers pour inverser la courbe en dix ans
La trajectoire actuelle n’est pas une fatalité : avec une volonté politique affirmée et des investissements stratégiques, l’Afrique peut inverser la courbe et absorber une large partie de sa jeunesse dans l’emploi productif au cours de la prochaine décennie. Cinq leviers précis et mesurables s’imposent. Le premier est l’agro-industrie locale, en visant la transformation sur place d’au moins 40 % du cacao, du café ou du coton d’ici 2035, ce qui pourrait générer près de cinq millions d’emplois dans les chaînes de valeur alimentaires. Le deuxième est l’énergie et la logistique, en réduisant les pertes techniques d’électricité sous 15 % et en modernisant les corridors routiers et ferroviaires, chaque point de baisse du coût logistique libérant la croissance de milliers de PME. Le troisième repose sur les zones d’emploi secondaires, en implantant 200 pôles industriels proches des villes intermédiaires et articulés avec des formations techniques adaptées, afin d’ancrer le développement au-delà des capitales. Le quatrième concerne le financement des PME, grâce à des garanties de portefeuille et au scoring numérique, avec l’ambition de doubler le volume de prêts en trois ans. Enfin, le cinquième levier est l’ouverture des marchés publics, en réservant 20 % des achats aux PME locales et en imposant des délais de paiement inférieurs à 30 jours.
Trois trajectoires possibles pour l’Afrique à l’horizon 2035
La différence entre les scénarios n’est pas démographique : elle est politique et économique. Le continent est face à un choix décisif : continuer sur sa trajectoire actuelle ou engager des réformes plus profondes. Les scénarios ci-dessous illustrent les écarts colossaux qui séparent une Afrique en stagnation d’une Afrique transformée (Scénario actuellement indisponible pour des raisons de mise à jour). Dans le scénario inertiel, la croissance de 4 % par an ne suffit pas à absorber l’explosion démographique : seuls 3 millions d’emplois formels sont créés chaque année et le sous-emploi reste massif, au-delà de 55 %. Le scénario de réformes partielles montrerait qu’avec un investissement privé porté à 18 % du PIB et une stimulation ciblée de l’industrie légère, l’Afrique pourrait doubler la création annuelle d’emplois formels à environ 6 millions et réduire le sous-emploi à 40 %. Mais c’est le scénario de réformes ambitieuses qui changerait véritablement la donne : une productivité manufacturière en hausse de 4 % par an, soutenue par une agro-industrie renforcée et l’essor des services numériques, permettrait de générer près de 10 millions d’emplois formels par an et de ramener le sous-emploi sous la barre des 25 %.
Un choix de société
La question est simple : l’Afrique veut-elle continuer à gérer la pénurie ou investir dans les conditions de l’emploi futur ? Les demi-mesures ont montré leurs limites : la croissance sans transformation ne crée pas d’emplois durables, les aides sans stratégie n’éteignent pas la frustration, les formations sans industrie produisent des diplômés sans travail. Le continent n’a pas une éternité devant lui. La fenêtre démographique se refermera d’ici 2045. Les vingt prochaines années décideront si l’Afrique devient la locomotive démographique et économique du XXIᵉ siècle ou si elle reste prisonnière d’un cycle de survie et de dépendance. Former davantage de jeunes ne crée pas d’emplois ; investir pour qu’ils aient des emplois à occuper, oui. L’Afrique ne manque ni de bras ni d’énergie, mais d’emplois capables de donner à ces bras une dignité et un avenir. C’est sur ce terrain, et sur lui seul, que se joue le véritable pari du développement.