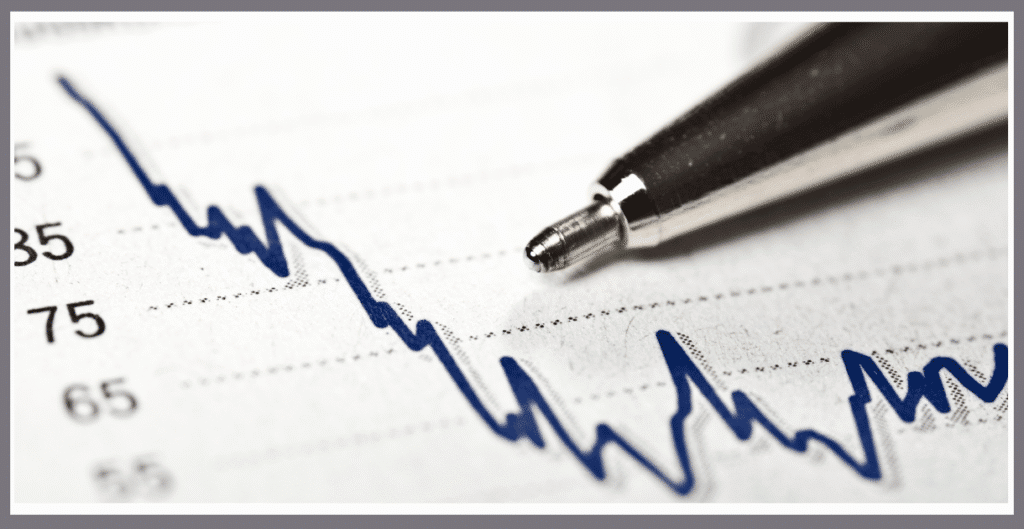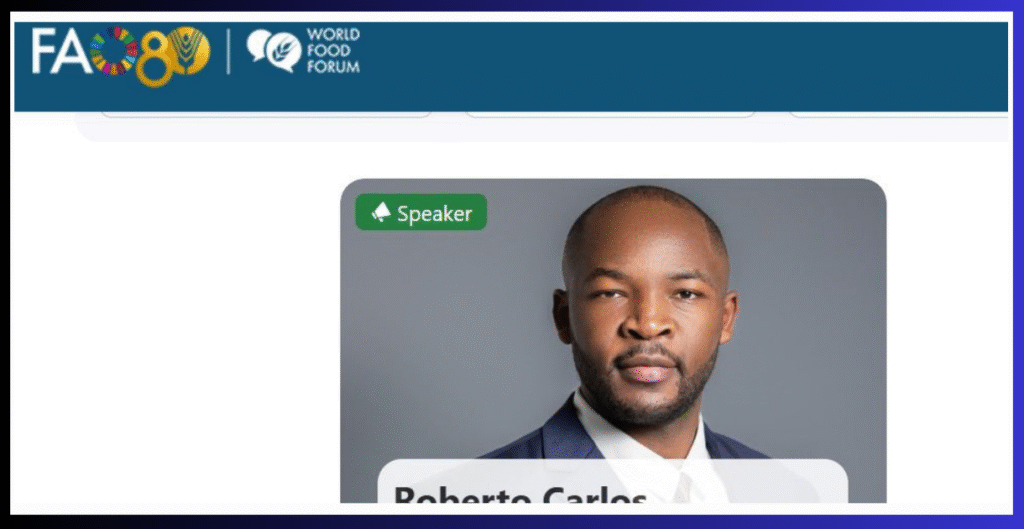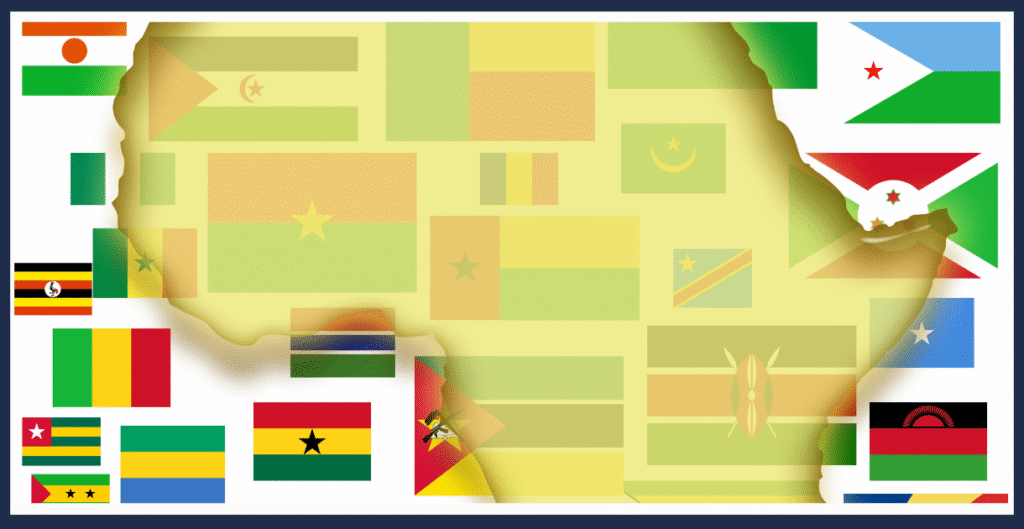Pourquoi parler de non-linéarité, ici et maintenant ?
La moitié de la valeur économique mondiale dépend directement ou indirectement de la nature, soit un ordre de grandeur voisin de 44 000 milliards de dollars de production annuelle. Une partie significative de l’intermédiation financière continue cependant de traiter cette dépendance comme si les relations étaient proportionnelles, réversibles et stables. Les systèmes écologiques obéissent à des dynamiques de seuils et de régimes. Une pression graduelle peut provoquer un changement d’état soudain, puis une persistance dans ce nouvel état qui résiste aux politiques de correction. Les modèles financiers standards, calibrés pour des chocs lisses et des distributions quasi normales, sous-estiment alors les pertes potentielles, les corrélations extrêmes et les irréversibilités. En pratique, nous gérons un portefeuille d’actifs réels dont la productivité dépend d’inputs écosystémiques non linéaires avec des outils statistiques conçus pour une autre classe de risques.
Biodiversité & Finance : Chiffres clés
44 000 Mds $ d’activité économique mondiale
dépendent directement ou fortement des services écosystémiques
(soit plus de la moitié du PIB global).
La dépréciation du capital naturel par habitant
a chuté de –20 % depuis 1995
(–40 % en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient).
Les flux vers les solutions fondées sur la nature
atteignaient ~200 Mds $ en 2022,
alors qu’il faudrait 542 Mds $/an d’ici 2030.
Près de 7 000 Mds $/an soutiennent encore des activités
« nature-négatives ».
Ce que la science nous dit : des systèmes qui basculent
Les travaux sur les basculements écologiques montrent que lacs, récifs et forêts peuvent franchir des points critiques sous l’effet combiné de nutriments, de fragmentation et de chaleur. La conséquence économique est claire. La gestion optimale ne consiste plus à optimiser des moyennes, mais à éviter des zones où la variance explose, les fonctions de production se déplacent et les coûts marginaux deviennent discontinus. Les synthèses récentes sur l’Amazonie décrivent des trajectoires plausibles de transition vers des états plus secs si sécheresses, incendies et déforestation se renforcent. Dans un tel scénario, la valeur actuelle nette de nombreux actifs agricoles, hydriques et d’infrastructures se contracte simultanément, et les risques assurantiels se re-tarifient de manière abrupte. La non-linéarité n’est donc pas un détail biophysique, c’est un déterminant du prix du capital.
Des signaux économiques déjà visibles
Les autorités monétaires et prudentielles relient désormais dégradation de la nature, cycle des prix et stabilité financière. La perte de zones humides côtières accroît les dommages macroéconomiques en cas d’événements extrêmes et se transmet aux bilans bancaires via la sinistralité, la valeur des collatéraux et la hausse des primes d’assurance. Les études de dépendance des portefeuilles montrent aussi une exposition directe aux services écosystémiques. Un tiers environ des encours analysés dans certains systèmes financiers européens dépend fortement d’au moins un service naturel, ce qui crée un canal de choc physique et un canal de transition. À l’échelle globale, le constat est cohérent. Si plus de la moitié du PIB mondial est adossée à des contributions de la nature, alors la dégradation de ces contributions doit être traitée comme un facteur de risque systémique plutôt que comme une externalité marginale.
La richesse inclusive
Le PIB mesure un flux de valeur ajoutée. La soutenabilité dépend d’un stock d’actifs. La richesse inclusive consolide capital produit, capital humain et capital naturel, et tient compte d’actifs habilitants comme la qualité des institutions, la confiance et la connaissance. Le principe d’arbitrage est simple. Une économie progresse si sa richesse inclusive par habitant ne diminue pas, après dépréciation de tous les capitaux. Cela exige des prix d’ombre qui reflètent la contribution marginale de chaque actif au bien-être intergénérationnel, y compris lorsque cette contribution dépend d’effets de seuil. Les chiffres récents confirment le décalage entre flux financiers et besoins réels. Les investissements annuels dans les solutions fondées sur la nature se situent autour de 200 milliards de dollars alors que les trajectoires compatibles avec les objectifs climat et biodiversité impliquent environ 540 milliards de dollars par an d’ici 2030. Dans le même temps, plusieurs milliers de milliards de dollars continuent d’affluer vers des activités qui déprécient le capital naturel. Tant que cette incohérence persiste, une partie de la croissance enregistrée n’est que la liquidation implicite d’actifs écologiques.
Le cœur du problème de risque : variances, queues grasses et actifs échoués
La perte de biodiversité augmente la variance des rendements des services écosystémiques, par exemple la pollinisation ou la régulation hydrologique. Elle accroît aussi la covariance entre secteurs qui partagent la même base écologique. Les fonctions de production deviennent plus volatiles, les distributions de pertes présentent des queues grasses et la corrélation s’intensifie en période de stress. Ce triptyque justifie des décotes plus élevées sur des flux de trésorerie dépendants de la nature, même lorsque les fondamentaux micro restent inchangés à court terme. Par ailleurs, la montée en puissance des politiques publiques climatiques et biodiversité transforme une partie du capital produit en actifs échoués. Des infrastructures ou modèles d’affaires intensifs en nature voient leur coût du capital augmenter, leurs collatéraux perdre de la valeur et leurs revenus anticipés se contracter. La logique de la transition signifie que ce risque de re-notation est plus rapide près des seuils biophysiques et réglementaires.
Ce que la gouvernance change déjà
Le cadre mondial biodiversité adopté à Montréal renforce trois leviers. Premièrement, la transparence. Les entreprises et les institutions financières sont appelées à évaluer, divulguer et réduire leurs dépendances et impacts nature. Deuxièmement, l’alignement des flux. Les budgets publics et l’intermédiation privée doivent progressivement se réaligner vers des activités nature positives, avec des bornes explicites sur les pertes d’habitats et l’intégrité des écosystèmes. Troisièmement, la planification. Les feuilles de route sectorielles intègrent des objectifs mesurables qui se traduisent en normes, en critères d’éligibilité et en signaux de prix. En parallèle, la TNFD fournit un canevas de gouvernance, de stratégie, de gestion des risques et de métriques. Les superviseurs, via leurs réseaux de banques centrales, commencent à explorer des stress tests qui intègrent risques physiques et risques de transition nature.
Que faire concrètement : sept inflexions stratégiques
Première inflexion, passer de l’analyse projet à la gestion de portefeuille d’actifs réels sous contraintes biophysiques. La due diligence doit intégrer données spatiales, télédétection, hydrologie et dynamique d’usage des terres afin d’identifier les zones de transition où la probabilité de basculement est la plus élevée. Deuxième inflexion, mesurer de façon consistante dépendances et impacts avec des outils reconnus et documenter le lien avec les hypothèses de revenus et de coûts. L’important est la traçabilité des données et la cohérence entre métriques physiques, monétaires et scénarios. Troisième inflexion, intégrer la pluralité des valeurs dans la décision. Certaines limites écologiques doivent fonctionner comme des bornes non négociables, tandis que les évaluations monétaires marginales éclairent l’arbitrage à l’intérieur de ces bornes. Quatrième inflexion, utiliser des scénarios non linéaires et des stress tests. Les équipes de risque doivent tester ruptures d’assurance, perte de collatéraux, chocs de prix agricoles, effets en cascade sur chaînes d’approvisionnement. Cinquième inflexion, réallouer les flux. Tripler les financements des solutions fondées sur la nature d’ici 2030, réduire les subventions et crédits qui déprécient le capital naturel, créer des produits adaptés comme obligations vertes et bleues, dettes contre nature ou couvertures paramétriques. Sixième inflexion, aligner reporting et incitations. Lier la rémunération des dirigeants à des cibles scientifiques sur la nature et articuler les divulgations avec les politiques publiques, y compris la commande publique. Septième inflexion, outiller les autorités macro-prudentielles. Intégrer la nature dans les cadres de collatéral, dans les haircuts, dans les tests de résistance et dans l’orientation macro-financière de long terme.
métriques et les angles morts
Tout ne doit pas être monétisé. La monétisation est utile pour prioriser des investissements à l’intérieur d’un espace de faisabilité écologique. Elle devient trompeuse lorsqu’elle prétend substituer un prix à une borne biophysique qui, une fois franchie, change l’état du système. La discipline consiste à articuler trois couches. D’abord, des seuils écologiques explicites qui définissent l’acceptable. Ensuite, des scénarios de transition qui décrivent des chemins plausibles de réallocation du capital et de re-tarification des risques. Enfin, des métriques financières qui internalisent ces informations dans le coût du capital, les provisions et la sélection des actifs. Les angles morts classiques restent la corrélation endogène en période de stress, la sous-estimation de la dépendance spatiale et la tentation d’agréger des signaux hétérogènes sans tenir compte des régimes.
changer de paradigme de capital, pas de vernis
Traiter la biosphère comme un actif de fondation change la théorie et la pratique. La mesure pertinente du progrès est la richesse inclusive par habitant, pas la seule expansion d’un flux. Les décisions d’investissement et de politique économique doivent être évaluées à l’aune de leur effet sur le stock consolidé de capital produit, humain et naturel. Tant que la comptabilité nationale ignore la dépréciation du capital naturel, la croissance peut masquer une érosion du principal. La science rappelle que les systèmes écologiques comportent des seuils et des irréversibilités. La régulation introduit transparence et réallocation des flux. La finance dispose déjà des briques techniques pour intégrer ces réalités dans la gestion des risques, la tarification et la gouvernance. Le coût de l’inaction n’est pas seulement élevé. Il est, par nature, non linéaire.
Que retenir ?
- Plus de 44 000 milliards $ d’activité économique dépendent directement de la biodiversité et des services écosystémiques.
- Les écosystèmes réagissent de manière non linéaire, avec des points de bascule irréversibles qui bouleversent nos modèles financiers.
- Les risques « nature » sont déjà visibles : 36 % des portefeuilles financiers néerlandais dépendent fortement de services écologiques, exposant le système bancaire à des ruptures.
- Le PIB masque la dépréciation du capital naturel ; seule la richesse inclusive (capital produit, humain, naturel et actifs habilitants) reflète la soutenabilité.
- La solution : intégrer scénarios non linéaires, stress tests nature, et réallocation massive des flux (200 → 542 Mds $/an pour les solutions fondées sur la nature) afin d’éviter des actifs échoués et stabiliser l’économie globale.