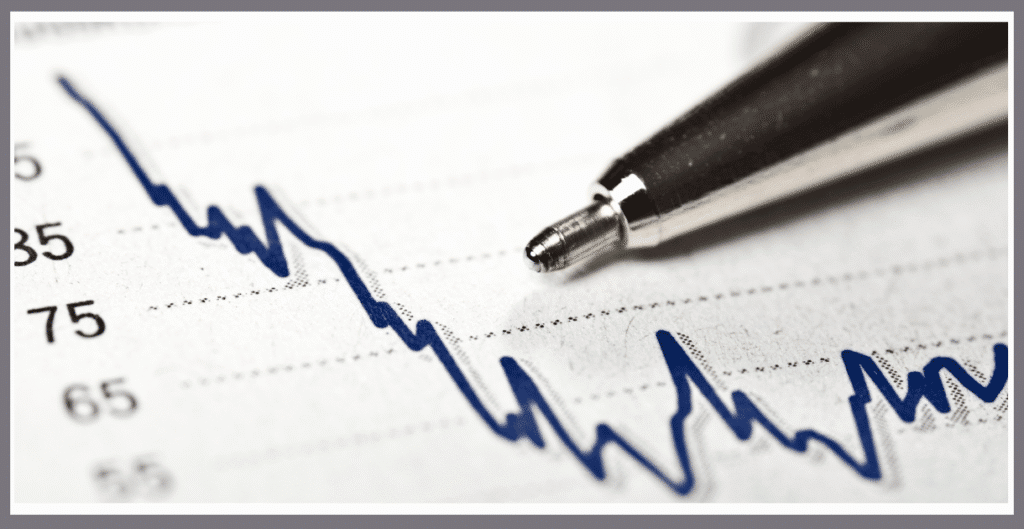Le paradoxe de la nature : survie ou marchandise ?
La crise mondiale de la biodiversité ne relève plus d’un constat abstrait : elle est devenue une urgence existentielle qui menace la stabilité de nos sociétés. La disparition d’espèces, l’effondrement d’écosystèmes et la dégradation rapide des sols, des océans et des forêts rappellent que la nature n’est pas un décor, mais la condition de notre survie collective. Pourtant, un paradoxe persiste : pour la protéger, certains estiment nécessaire de la valoriser économiquement, tandis que d’autres dénoncent cette approche comme une réduction dangereuse de la nature à une simple marchandise. Cette tension, qui oppose l’impératif de survie à la crainte de la commodification, alimente une véritable « crise des valeurs » au cœur de la biodiversité et du climat.
Pendant longtemps, l’économie a considéré la nature comme une ressource infinie et gratuite, un stock à exploiter et un réceptacle illimité pour nos déchets. Le Produit Intérieur Brut, indicateur phare de la performance économique, ignore la dépréciation du capital naturel, créant une illusion de croissance alors que nous érodons en réalité les fondements de notre prospérité. La Dasgupta Review a mis en lumière cette contradiction en rappelant que nous sommes « intégrés dans la nature » et que l’air, l’eau, les sols fertiles ou la régulation du climat constituent un capital vital, au même titre que le capital humain ou produit. L’invisibilité de ces services essentiels dans nos comptes nationaux entraîne une surexploitation chronique : ce qui a le plus de valeur pour notre survie n’a pas de prix sur le marché. C’est ainsi que la déforestation amazonienne, par exemple, est justifiée au nom de bénéfices économiques immédiats, alors même qu’elle rapproche la planète d’un basculement climatique irréversible.
Les multiples façons de donner de la valeur à la nature
Pour sortir de cette impasse, il est indispensable de reconnaître que la nature porte une pluralité de valeurs qui ne se limitent pas aux prix de marché. L’IPBES distingue trois grandes catégories : les valeurs instrumentales, qui voient la nature comme une ressource utile pour satisfaire des besoins humains ; les valeurs intrinsèques, qui affirment que la vie a une valeur en soi indépendamment de son utilité ; et les valeurs relationnelles, qui expriment l’importance des liens identitaires, culturels ou spirituels avec l’environnement. Ces dernières sont particulièrement fortes dans le Sud global, avec des concepts comme le Buen Vivir andin ou l’Ubuntu africain, qui rappellent l’interdépendance entre les humains et la nature. Pourtant, les politiques publiques privilégient presque exclusivement le cadre « vivre de la nature », réduisant les écosystèmes à des stocks exploitables, et marginalisant les visions qui invitent à « vivre avec » ou « en tant que » nature.
Les 3 grandes valeurs de la nature (IPBES)
L’IPBES distingue trois familles de valeurs qu’il faut articuler
pour guider des décisions légitimes et durables.
- Instrumentales : la nature comme moyen pour répondre à des fins humaines (bois, eau, régulation du climat, loisirs).
- Intrinsèques : la vie a une valeur en soi, indépendante de son utilité (dignité du vivant, espaces sacrés, non-négociables).
- Relationnelles : liens d’identité, de réciprocité et de soin entre personnes et milieux (ex. Buen Vivir, Ubuntu).
L’évaluation monétaire : solution ou piège ?
C’est dans ce contexte qu’a émergé l’évaluation monétaire de la biodiversité (ETB), présentée comme une réponse pragmatique pour parler aux décideurs. En assignant un prix à la séquestration du carbone, à la régulation hydrique ou aux récifs coralliens, l’ETB promet de rendre visibles des bénéfices invisibles et d’attirer des financements pour la conservation. Mais ce langage économique est un outil à double tranchant. Ses limites sont bien connues : il risque de réduire la nature à une logique marchande, d’accentuer les inégalités en donnant plus de poids aux préférences des riches, et de reposer sur des chiffres méthodologiquement fragiles. Surtout, l’impact réel reste marginal : à peine 5 % des évaluations influencent effectivement les politiques. L’exemple de l’estimation de Costanza et al. en 1997, qui chiffrait les services écosystémiques mondiaux à 33 000 milliards de dollars, illustre ce paradoxe : spectaculaire, mais inutilisé faute de lien concret avec les décisions.
Entre économie et éthique : dépasser l’opposition
Plutôt que d’opposer économie et éthique, il est plus juste de reconnaître que les outils économiques ne sont pas neutres mais stratégiques. L’approche des ordres de grandeur de Boltanski et Thévenot permet de comprendre que chaque action peut être justifiée selon différents registres marchand, industriel, civique, domestique, inspiré et que les évaluations sont souvent des compromis hybrides. Par exemple, les marchés carbone reposent à la fois sur une logique industrielle de mesure, une logique marchande de prix et une logique civique de norme collective. Loin d’être des vérités scientifiques, les chiffres produits par les économistes servent alors de munitions argumentatives dans les négociations. La question centrale devient donc : qui produit l’évaluation, dans quel contexte, et au service de quels intérêts ?
5 pistes pour dépasser le paradoxe
- Comptabiliser la nature : adopter des mesures de richesse inclusive au-delà du PIB pour intégrer le capital naturel.
- Reconnaître la pluralité des valeurs : combiner approches monétaires et non monétaires avec des processus délibératifs.
- Clarifier l’usage des évaluations : traiter l’ETB comme un outil stratégique (transparence, limites, contexte), pas comme une vérité.
- Renforcer la légitimité : participation des communautés, prise en compte des savoirs locaux et régulation publique crédible.
- Transformer les sensibilités : éducation, culture et récits qui rendent la destruction de la nature socialement inacceptable.
Résistances et alternatives : quand les communautés réinventent la valeur
À côté de ces débats globaux, de nombreuses communautés réinventent localement des modèles où économie et conservation se renforcent mutuellement. À Palau, une immense aire marine protégée est financée par le tourisme durable, protégeant les récifs coralliens tout en générant des revenus. Dans les Andes colombiennes, des projets de reforestation associent les agriculteurs à des pratiques durables qui améliorent à la fois la biodiversité et la sécurité alimentaire. Au Botswana, des communautés locales gèrent le tourisme autour des éléphants et partagent les revenus, faisant de la conservation une opportunité plutôt qu’une contrainte. Ces initiatives démontrent qu’il est possible de préserver la nature en la valorisant autrement, non pas comme une marchandise isolée, mais comme un bien commun porteur de justice sociale et de prospérité durable.
Pour dépasser le paradoxe commodification/survie, il faut désormais transformer en profondeur notre manière de compter, de gouverner et de nous relier à la nature. Les politiques publiques doivent aller au-delà la somme de valeurs économiques ajoutées et adopter des mesures de richesse inclusive qui reflètent notre dépendance au capital naturel. Les processus participatifs doivent donner une place centrale aux savoirs autochtones et aux communautés locales. L’éducation doit transformer nos sensibilités, en nous apprenant à voir la destruction comme une profanation de notre maison commune. Enfin, l’innovation économique doit encourager des modèles hybrides économie circulaire, écotourisme, paiements pour services écosystémiques contextualisés capables de combiner efficacité économique et respect écologique.